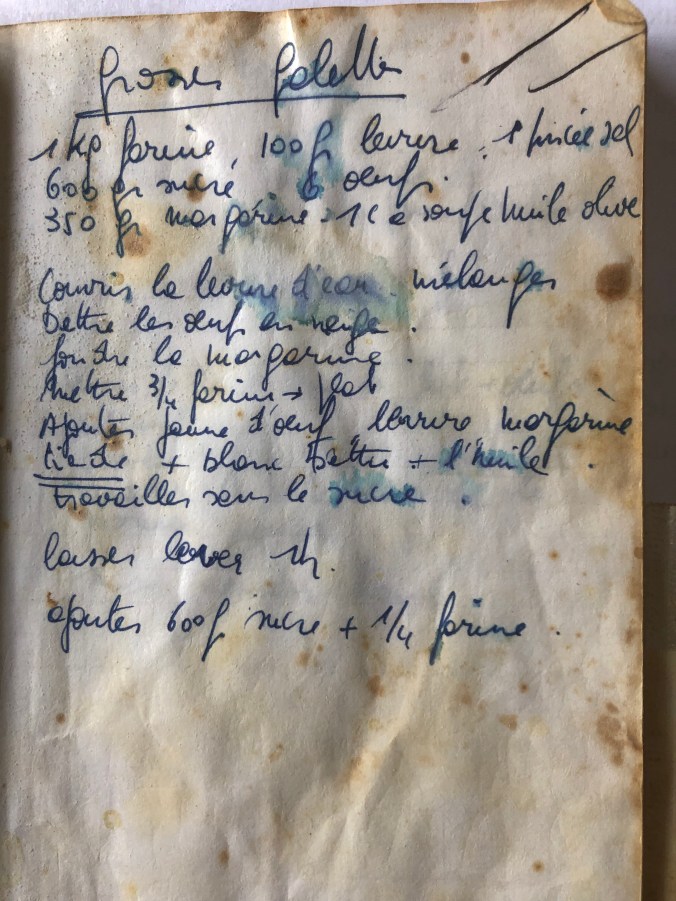Lorsque ma vue diminue, que je deviens presbyte, il me reste a mettre des lunettes, a trouver le filtre adéquat pour que le message, écrit noir sur blanc, depuis longtemps sur un document connu, me revienne clair et net dans l’esprit.
C’est un sujet quotidien, connu de tous. Chacun y est confronté.
Ici pourtant, avec cette image de bas-relief, je suis confronté à autre chose.
C’est neuf pour moi. Je n’ai pas changé de lunettes, au moment où cela m’est parvenu un flash dans la tête. Il y avait mystérieuse, une autre image, sur le même objet. J’entrai dans l’inconnu. Ce n’était plus un bas-relief mais un message venu de l’année 1750 qui me parlait.
Un voyage dans le temps ?
L’artiste inconnu, sculpteur sur bois, avait avec le concours d’un peintre, transmis un symbole, non pas secret, mais accessible s’il y avait de la part de celui qui regarde, un arrêt du temps d’activité, vers un temps d’attente, de méditation.
Puis brusquement, un relâchement, un étonnement, une découverte décapante.
Un symbole, un enseignement.
Surpris, étonné, enthousiaste, j’ai voulu partager ce passage, ce basculement interne, d’une sensation à une autre. La plupart du temps sans succès.
Mon voisinage, semblait a cent lieues du jeu proposé, me prenant pour un doux rêveur, réticent à tenter l’aventure, a quitter son train-train quotidien.
Bien sûr, il n’y avait qu’un jeu à faire sans bénéfice, sans utilité.
Au fond un voyage, vers d’autres perspectives.
C’est devenu une obsession, partager ce moment avec d’autres.
Pas évident ?
Inutile ? Improductif ?
Enter dans un lâcher-prise, momentané sans doute ou insécurisant. Qui sait
Double vue de ma part. Ou univers qui m’apporte des moments fastes pour affronter les turbulences de la société qui dérive, se durcit, se noirci.
Je ne peux m’empêcher non plus d’être en admiration pour ces artistes qui ont doublé la personnalité du bas-relief en superposant un symbole qui ouvre des perspectives.
Mais là on quitte le visuel pour entrer peut-être dans le domaine qui serait le lien avec l’endroit et les symboles d’enseignement, perdu au cours du temps.
Qui vivra verra.